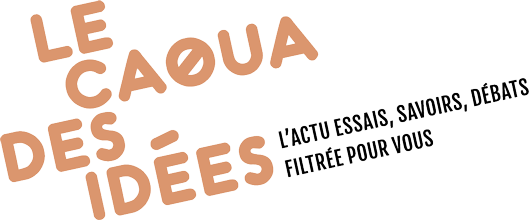Et voilà qu’un crabe méchant a emporté d’un coup notre amie Claire Auzias, le 6 août 2014. Il n’y a pas que la bourgeoisie pour faire ses mauvais coups au mois d’août. À la lecture ou à la relecture de quelques-uns de ses ouvrages, beaucoup comprendront la perte que représente sa disparition. Elle, la spécialiste de l’extermination si mal connue des Roms par les nazis et ses alliés, est décédée quatre jours après le 2 août, journée européenne de commémoration depuis 2015, du génocide. « Avec tristesse, ses amis n’entendront plus ses remarques souvent pertinentes, parfois un peu rugueuses, car Claire n’avait pas la langue dans sa poche, elle pouvait même parfois avoir la dent dure, mais ses réflexions ont toujours été marquées par une connaissance approfondie des sujets auxquels elle s’intéressait », disions-nous dans un premier hommage rendu, comme il se doit, dans Le Monde libertaire.
Entière, vive, jouant d’une culture immense, totalement indisciplinée mais toujours précise, l’historienne saisissait toutes les situations pour faire progresser une idée ou débusquer les faux-semblants. Reste qu’avant d’être une chercheuse reconnue de la déportation et de l’extermination des Tziganes, l’historienne des mémoires invisibles, Claire Auzias a vécu une drôle d’ego-histoire, existence difficile, tourmentée, romanesque. Elle en a fait le récit assez franc dans un livre d’entretiens avec Mimmo Pucciarelli, Claire l’Enragée (ACL, 2006).
Au début des années 2000, elle avait également trié, classé et remis en bonne historienne, « 4 cartons, 5 bobines de microfilms et 5 bobines de négatifs » à la Contemporaine (Centre documentaire interuniversités basé à Nanterre et spécialisé dans la collecte d’archives privées).
Ce don était assorti d’une condition : que tous ces documents soient accessibles après son décès. Le corpus est constitué de « correspondance, papiers personnels et pièces diverses (dont pièces judiciaires) concernant pour l’essentiel l’affaire dite de « la rue des Tables Claudiennes » (Lyon, août 1971), c’est-à-dire l’arrestation, la détention et le procès (1973) d’un groupe de militants d’origine anarchiste responsable de quelques braquages ». Une partie décisive de sa vie.
Née le 28 avril 1951 à Lyon, dans une famille d’enseignants communistes, Claire avait grandi dans le quartier de la Croix-Rousse, puis à Bron dans la banlieue lyonnaise. Derrière son paravent culturel, la famille était dysfonctionnelle, sous un régime patriarcal autoritaire. Son père, violent, qui battait régulièrement ses trois filles, la viola. Claire fuit le foyer. Elle a tout juste 17 ans ce mois de mai 1968. Elle se réinvente un foyer, celui d’un groupe d’amis. « Mai 1968 m’a sauvé », estimera-t-elle des décennies plus tard. Le 3 mai 1968, elle expérimente sa première manif avec ses copains de lycée, tous sympathisants du groupe anar Bakounine. Plus affective que politique pour Claire : l’anarchisme, elle ignore totalement ce que c’est. Celle que l’on nommera dans quelques mois, La « bande de la rue des tables-Claudiennes », sur les pentes de la Croix-Rousse, l’ignore encore, mais elle va connaître une intense odyssée politique, avec ses bonheurs et sa chute.
Ces petits militants constituent avant tout un groupe dont le trait commun est d’être en rupture familiale : Didier Gelineau est le fils d’un ingénieur de la raffinerie de Feyzin, Patrick Kuntzmann, d’un ancien chef de brigade de gendarmerie, Daniel Dante, d’un contremaître mais aussi Danielle Barbezieux, Everest Pardell et Claudine Guénivet, des enfants de petits entrepreneurs ou d’employés. Avec ses amis, Claire Auzias cofondent un Comité d’action lycéen (CAL 69), occupent la fac, participent au mouvement, s’enivrent de joie collective. Les bakhounistes s’allient avec des militants des Jeunesses communistes révolutionnaires, en dissidence avec leur direction nationale. Leurs actions communes, même si elles s’avéraient « mineures » selon les souvenirs de la jeune fille, se multipliaient : Piquets de grève, aide à l’occupation, érections de barricades et surtout rencontre avec les « trimardeurs » lyonnais – ces mauvais garçons considérés par l’extrême gauche comme le lumpenprolétariat authentique de ces années de société de consommation. Nos libertaires lyonnais font un bout de chemin avec les trimardeurs (ou encore loulous, zonards et katangais). Une barricade reste leur fait de gloire révolutionnaire. Dans la nuit du 24 mai, des émeutiers envoient un camion sur les forces de l’ordre. Un policier meurt d’un accident cardiaque, mais les responsables tout désignés, ce sont les trimardeurs, alors que tous les étudiants et lycéens ont participé à l’émeute. Les théoriciens de la révolution s’égaient et ce son bien trois représentants homologués du « Peuple » qui se trouvent arrêtés et enfermés en préventive. Ils seront acquittés un an après. Claire Auzias a utilisé ses outils d’historienne pour ne pas oublier les Trimards (ACL, octobre 2017) dans les commémorations compassées de mai 68.
L’après-mai en décompensation va être un tunnel de dope, d’errance en auto-stop et de délinquance. La petite bande lyonnaise goûte aux joies de la défonce : haschisch, LSD, amphétamines, héroïne. Ils en deviennent fervents, bourlinguent vers l’Afrique ou l’Orient. Les autorités pakistanaises flanqueront en prison Gelineau qui ne possédait pas de visa. De corruption en dérives jusqu’en Afghanistan, il s’est délabré avec les assauts de la malaria et de dysenterie amibienne. À Lyon, rue des Tables-Claudiennes, où il revint finalement dans un état cadavérique, le petit ami de Claire Auzias et personnalité influente, dégoûté par le gauchisme, estima une fois retapé, que c’était le temps pour le groupe de se procurer des armes et passer à la « récupération individuelle ». Claire Auzias s’en expliquait auprès d’un journaliste de Lyon en 2020 : « Puisque tout était perdu et que les pavés n’avaient pas suffi , il ne restait que les armes. 20 ans après la guerre, les armes étaient très présentes dans les esprits » Mais contrairement au terrorisme international qui se développait, notamment en Allemagne avec la Fraction Armée rouge, les anciens du groupe Bakhounine n »y nourrissaient aucune référence : « C’était des marxistes, ils pensaient qu’on allait s’attaquer à l’État par des actions contre lui. Nous ne croyions pas à cela, plaidait encore Claire Auzias. Nous étions pour l’abandon des formes traditionnelles de la politique. Pour nous, tout était politique. Et tout ce qu’on fait pour résister est une résistance politique. Donc si l’on va piquer la caisse de n’importe quel exploiteur notoire, c’est un geste aussi radical que les attentats terroristes ».
De mai à août 1971, ils commirent des braquages – une banque, une pharmacie, le restaurant du centre régional des œuvres universitaires (CROUS), une coopérative, un ferrailleur, deux bureaux de poste dont celui de la rue Duguesclin, leur plus beau coup, avec 36 000 francs empochés. Ils se droguaient, s’alcoolisaient, se vantaient haut et fort dans les cafés de la Croix-Rousse, décrétaient qu’ils en avaient « marre de tout ». Le 12 août 1971, dans la soirée, tout partit en vrille. Dans une brasserie, Gelineau sous acides et imprégné de pastis, provoqua un consommateur, cherchant la bagarre. Ses amis le sortirent de ce mauvais pas, et retournèrent à leur QG de la rue des Tables-Claudiennes. Mais Gelineau en voulait à la terre entière, se battit avec Dante avant de s’emparer de la mitraillette que Kuzmann avait acheté au milieu lyonnais. Il mitrailla le studio, détruisant tout l’ensemble sono et la Fender qu’il s’était offerte avec l’argent des hold-up pour commencer une carrière rêvée de chanteur rock. Puis il déboula dans la rue, torse nu, arme en bandoulière et s’arrêta net devant un fourgon de police en patrouille, qu’il mit en joue, en criant au conducteur : « Je te flingue ! ». Une phrase qui pèsera lourd au procès. En riposte, il survivra à cinq balles dans le corps, et plus de cinq mois de soins.
Toute la petite bande fut arrêtée, à l’exception de Claudine Guénivet qui finira par se rendre au bout de 8 mois de cavale. Les policiers sont remontés à Claire Auzias, étudiante en sociologie, et principale locataire du studio de la rue des Tables-Claudiennes. Les enquêteurs y ont trouvé trois armes de poing. La jeune femme est détenue durant huit mois. Le 16 août 1972, elle épouse Didier Gélineau à la prison Saint-Paul de Lyon, où il est détenu, Et où il décède le 24 février 1973, suite à une prise massive de barbituriques. Le procès en mars se déroula sans lui, même si l’ombre portée de David Gelineau écrasa le reste de la tribu de « désespérés », comme le notera le chroniqueur judiciaire du Monde, Jean-Marc Théolleyre. Claire Auzias, benjamine du groupe, et qui n’a jamais fait le coup de feu, obtint du sursis. Les autres écopaient de peines allant de cinq ans de prison avec sursis à neuf années de prison fermes – quatre pour la seconde femme du groupe, qui, elle, était montée au « braco ».
Libérée et veuve à 22 ans, Claire quittait la France pour l’Inde, où elle replongeait dans des substances plus dures. Elle finit par être rapatriée, se désintoxiquer et entama une nouvelle vie. « Je suis rentrée dans le rang », expliquera-t-elle dans son livre de témoignage, Claire l’Enragée. Elle tenait tout de même son rang : celui turbulent et créatif des militantes des groupes féministes du mouvement libertaire. Pendant ses années de militantisme, elle participa à sa première œuvre collective, un recueil important de textes d’Emma Goldman : Une tragédie de l’émancipation féministe (Syros, 1978). Elle mit aussi en lumière grâce à sa réflexion, la place des femmes dans les grèves. Elle a coécrit avec Annick Houel La grève des ovalistes (Payot, 1982) dans laquelle elles documentaient l’un des premiers conflits sociaux des ouvrières du textile lyonnais. Surtout, avec les années 80, elle entamait un travail universitaire qui demeure pionnier : rendre à Lyon sa mémoire libertaire.
 Le hasard de la vie et de la recherche l’a conduit vers un nouveau champ d’études : le Porajmos (« dévorer » en romani) ou Samadaripen, soit le génocide mal connu des Tsiganes, 300 000 à 500 000 personnes déportées et assassinées par le régime nazi. En 1991, elle commence à travailler pour l’Institut de l’Enfance et de la Famille sur les familles Roms en Europe de l’Est. Rapidement, elle publie une étude sur les familles Roms de l’Europe de l’Est, analyse le poids du génocide et la domination du communisme. Elle multiplie les travaux soit d’enquête soit de synthèse. Claire considérait que ce peuple nomade symbolisait à la fois la liberté de déplacement, un peu comme un miroir de son itinéraire, mais aussi les différentes formes d’oppression, étatique mais aussi clanique, voire familiale. Elle a multiplié les travaux et les publications sur le sujet tout en restant en marge : la « tsiganologie » et surtout les « tsiganologues » lui cassaient les pieds. Normal, Claire était un peu hors norme dans le monde universitaire. Elle a parfaitement restitué les grands moments de la culture tsigane dans La Compagnie des Roms (ACL 1994), mis en perspective les mécanismes de persécutions mis en place en Europe dès le Moyen-Âge (les Funambules de l’histoire, La Digitale, 2002) et remarquablement expliqué, le Samudaripen, l’extermination des Tsiganes par les nazis (L’Esprit frappeur, 2000 et 2022). Toujours hors des sentiers battus, elle s’est aussi intéressée aux Tsiganes en terre d’Israël (Égrégores/ Indigènes, 2013), qui doit se lire comme un véritable plaidoyer internationaliste et cosmopolite.
Le hasard de la vie et de la recherche l’a conduit vers un nouveau champ d’études : le Porajmos (« dévorer » en romani) ou Samadaripen, soit le génocide mal connu des Tsiganes, 300 000 à 500 000 personnes déportées et assassinées par le régime nazi. En 1991, elle commence à travailler pour l’Institut de l’Enfance et de la Famille sur les familles Roms en Europe de l’Est. Rapidement, elle publie une étude sur les familles Roms de l’Europe de l’Est, analyse le poids du génocide et la domination du communisme. Elle multiplie les travaux soit d’enquête soit de synthèse. Claire considérait que ce peuple nomade symbolisait à la fois la liberté de déplacement, un peu comme un miroir de son itinéraire, mais aussi les différentes formes d’oppression, étatique mais aussi clanique, voire familiale. Elle a multiplié les travaux et les publications sur le sujet tout en restant en marge : la « tsiganologie » et surtout les « tsiganologues » lui cassaient les pieds. Normal, Claire était un peu hors norme dans le monde universitaire. Elle a parfaitement restitué les grands moments de la culture tsigane dans La Compagnie des Roms (ACL 1994), mis en perspective les mécanismes de persécutions mis en place en Europe dès le Moyen-Âge (les Funambules de l’histoire, La Digitale, 2002) et remarquablement expliqué, le Samudaripen, l’extermination des Tsiganes par les nazis (L’Esprit frappeur, 2000 et 2022). Toujours hors des sentiers battus, elle s’est aussi intéressée aux Tsiganes en terre d’Israël (Égrégores/ Indigènes, 2013), qui doit se lire comme un véritable plaidoyer internationaliste et cosmopolite.
À partir de 2004, Claire devint également éditrice et passeuse de savoirs. Lors de son séjour marseillais, outre sa participation aux activités du Centre international de recherches sur l’anarchisme (Cira), elle a participé aux petites éditions Égrégores (aujourd’hui marque reprise par des éditeurs lyonnais qui publient… des livres d’entreprise et de marketing). Sous son égide, la structure éditoriale publia plusieurs livres importants comme Dix-huit ans de bagne, ou les mémoires du bagnard anarchiste yiddishophone Jacob Law (2005), Au Maquis de Barrême d’Oxent Miesseroff (2006), ou encore Camus et les libertaires, malicieusement signé Lou Marin, et surtout, Chœur de femmes tsiganes (2009).
Sa bibliographie profuse d’ouvrages et d’articles de revue (malheusement la plupart du temps épuisés) utilise des angles d’approche souvent originaux comme son Paris révolutionnaire (Éditions libertaires, 2001, 2019). On lui doit aussi une petite biographie très personnelle de Louise Michel (Éditions libertaires 1999, qu’elles seraient très bien inspirées de rééditer) ou encore un petit conte un brin canaillou, Les aventures extraordinaires de Laplume et Goudron aux mêmes éditions.
Une phrase mantra aura structuré toute sa démarche : « « La mémoire est notre point de départ et notre priorité ». On la fait nôtre bien volontiers.
![]() Sylvain Boulouque avec Emmanuel Lemieux
Sylvain Boulouque avec Emmanuel Lemieux